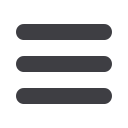
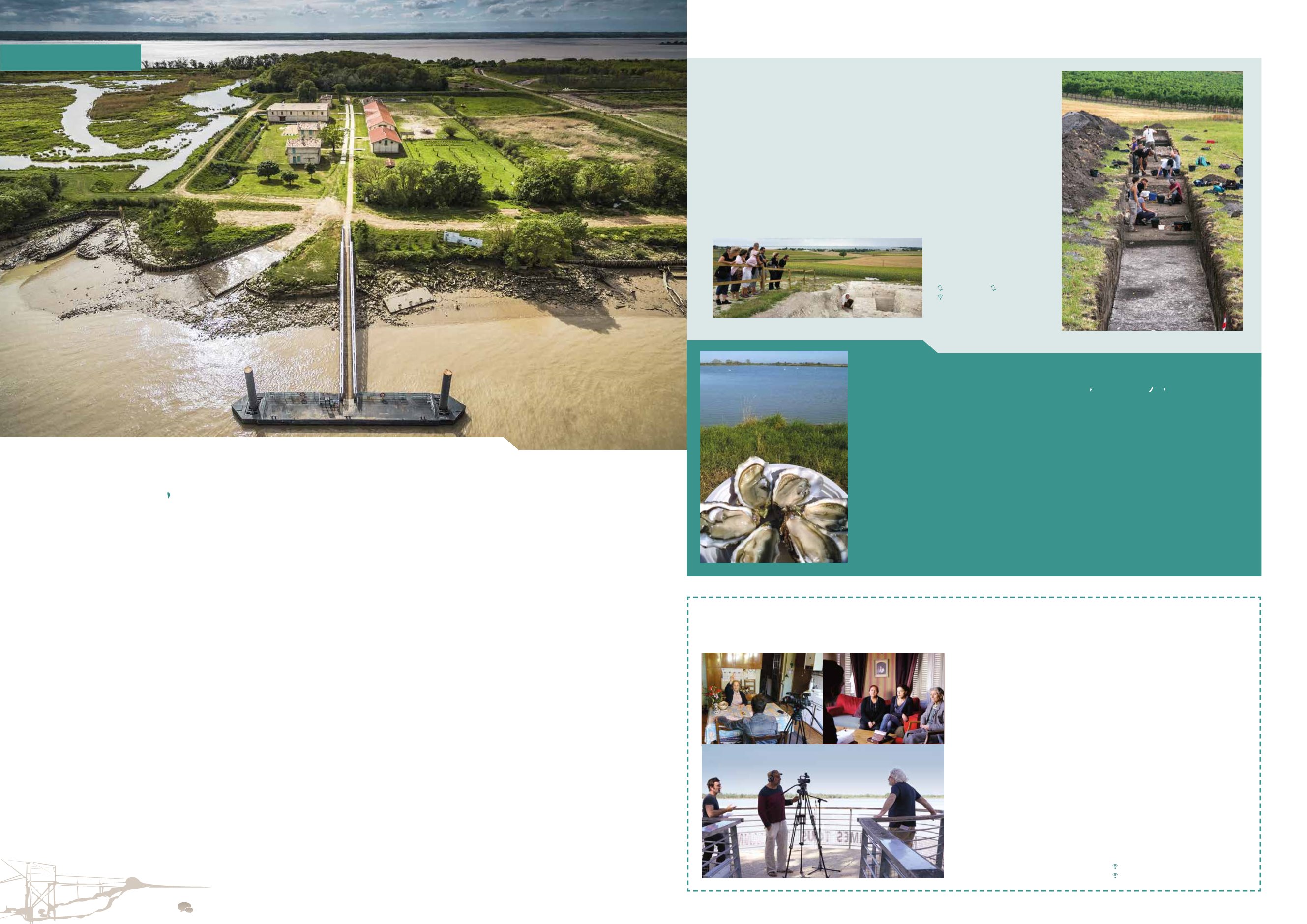
Rubrique ???
5
4
Retrouvez plus d’articles et d’infos pratiques sur
www.estuaire-gironde.frsciences
Pollutions chimiques, peuplements piscicoles, botanique, fonctionne-
ment hydraulique, sédimentologie….
« L’estuaire de la Gironde a une
particularité mondiale : il est étudié de manière récurrente. C’est l’un
des mieux suivis, depuis le plus longtemps et de manière la plus
complète »
estime Benoît Sautour, président du Conseil scientifique de
l’Estuaire. Ce qui ne signifie pas que tout est connu, loin de là, tant le
milieu est complexe.
Dans les années 90, l’agence de l’eau Adour-Garonne et l’IFREMER
1
éditaient un « livre blanc de l’estuaire de la Gironde ». A la fois tra-
vail de synthèse d’études scientifiques et analyse de son état global,
cet ouvrage concluait à
« un estuaire stable et mieux préservé que
d’autres»
. Pour Jérémy Lobry, spécialiste des poissons et directeur
de recherche au sein de l’IRSTEA
2
,
« ce n’est plus exactement le cas
aujourd’hui »
. Ses travaux révèlent en effet une population piscicole
en baisse constante depuis plusieurs années. En cause ? Principale-
ment la salinisation des eaux. Ce sont toutes ces évolutions, toutes ces
données, positives ou négatives, que le projet QUEST
3
, dernier né de la
collaboration entre l’Université et le SMIDDEST, permettra de rendre
lisibles et disponibles.
Au-delà de cet indispensable travail de synthèse et de mise en commun
des données, des laboratoires s’impliquent aussi quotidiennement au-
près de gestionnaires d’espaces naturels et de collectivités publiques.
Comment avez-vous procédé
pour ces rencontres ?
On a pris le temps de rencontrer 30 personnes
avec lesquelles on a mené deux entretiens de deux
heures chacun. Patrice Clarac, anthropologue à
l’université de Bordeaux, spécialiste de la mémoire
collective, nous a formés et a validé les outils,
essentiellement un guide d’entretiens très élaboré.
Il faut savoir ce que l’on cherche pour mobiliser
la mémoire. Au total, on a plus de 100 heures
d’entretiens filmés.
Que va devenir ce travail ?
On a passé une convention avec les archives
départementales de la Gironde pour qu’une partie
soit utilisable pour d’éventuels chercheurs. Ils sont
filmés, enregistrés et retranscrits à l’écrit. Tout sera
disponible aux archives et sur leur site internet.
On travaille aussi sur un web-documentaire qui
sera un outil pédagogique de découverte des îles
au travers de dix sujets thématiques. Il sera en
ligne dans un premier temps sur notre site et sur
celui de culture numérique du Conseil régional.
Enfin, on a écrit un texte à partir des entretiens
qui sera porté sur scène, notamment le 5 octobre
au Champ de Foire à Saint-André-de-Cubzac.
Existe-t-il un esprit îlien ?
Beaucoup de gens ont le sentiment d’avoir fait
partie d’une histoire. Un sentiment îlien s’est forgé
avec le temps, un sentiment d’appartenance à un
collectif. Est-ce qu’on peut parler de culture ? Pro-
bablement, mais ce n’est pas à nous de répondre.
On travaille sur une base scientifique mais on ne
se prend pas pour des scientifiques.
www.nousautres.fr www.culturesconnectees.frLa mémoire
comme héritage
Scruté, observé, détaillé, l’Estuaire est sous la loupe des chercheurs
depuis plus de 40 ans. Equipes universitaires, laboratoires et
gestionnaires publics s’allient pour mieux le comprendre. Sa faune,
sa flore, son patrimoine ou même la manière dont ses habitants s’y
sont adaptés : tout est passé au crible d’études qui éclairent son présent
tout autant qu’elles appuient les décisions qui engagent son avenir.
Jean-Luc Eluard
Plusieurs collaborations sont d’ailleurs en cours. L’une d’elles a com-
mencé comme un coup du sort : en décembre 1999, la tempête rompt
les digues à Mortagne-sur-Gironde, provoquant l’inondation de zones
agricoles qui redeviennent alors des marais. Main dans la main avec
le Conservatoire du Littoral et le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Poitou-Charentes, l’IRSTEA va alors engager une étude sur le retour de
différentes espèces aquatiques au sein de ce « nouvel » écosystème.
Expériences de renaturation
Cette première étude a nourri d’autres projets visant à remettre en eau
une partie des terres gagnées sur le fleuve. A Vitrezay, l’un des trois
plans d’eau douce créés artificiellement il y a dix ans pour des activités
de pêche et des animations nature, va en partie changer de vocation
et être connecté à l’Estuaire via un système de canaux et d’écluse,
de façon à contrôler l’apport en eau saumâtre du fleuve. L’objectif :
recréer un milieu plus naturel, dans lequel d’autres types d’espèces
pourront se développer. Là encore, les services de l’IRSTEA mais aussi
de Biosphère Environnement, institut de recherche associatif basé à
Mortagne-sur-Gironde, seront utiles pour accompagner la démarche,
en mesurer les impacts et suivre l’évolution de ce nouveau milieu.
Renaturation toujours : celle de l’Île Nouvelle. Si la tempête de
1999 agit comme un déclencheur, Xynthia en 2010 jouera le rôle
d’accélérateur. Leur passage conforte le Département de la Gironde,
gestionnaire, dans son projet de laisser l’eau de l’Estuaire recouvrir une
partie de ces terres iliennes. Les laboratoires EPOC
4
, Geo-transfert, le
Le retour dans les assiettes des huîtres du Médoc marque sans
doute la fin d’une longue parenthèse dans l’histoire de l’huître
estuarienne, qui faillit s’achever en 1996, lorsque la pollution au
cadmium venue du bassin minier de Decazeville conduisit à une
interdiction de consommation. C’était sans compter l’obstination de
quelques uns, persuadés que l’activité ostréicole pouvait renaitre
dans ce qui était, dans les années 50, l’une des principales zones de
production d’Europe.
Un groupe de travail aquaculture fait alors appel au laboratoire
EPOC, commun au CNRS et à l’université de Bordeaux 1, pour mener
les études toxicologiques nécessaires :
«Ils ont monté un protocole
d’études scientifiques de plus d’un an pour démontrer la faisabilité
de l’élevage des huîtres dans les marais. Un protocole très strict
et très construit qui a conclu qu’il n’y avait pas de risques pour
les humains.»
souligne Bérénice Lapouyade, chargée de mission
au CPIE* Curuma. Le fruit de cette collaboration entre décideurs
politiques et chercheurs CNRS permet alors que les choses
s’enchaînent vite. En 2014, la zone qui va de la Pointe de Grave
au Phare de Richard passe d’une interdiction de consommation
à consommable après purification.
« Potentiellement, ce sont
25 000 ha de polders qui peuvent être exploités »
estime Bertrand
Iung, aquaculteur à Saint-Vivien-de-Médoc, l’un des premiers à
s’être relancé dans les huitres. Depuis, six autres ostréiculteurs sont
revenus s’installer. Et la décision préfectorale d’autoriser six mois
d’affinage - cette période où l’huitre engraisse dans les marais et prend
tout son goût -, en décembre dernier, encourage tous les espoirs.
*Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Le Fâ n’a pas tout dit
Près de cent ans après les premières fouilles archéologiques et vingt-cinq ans après son ouverture au public, l’agglomération
antique du Fâ à Barzan continue de parler. Et elle est bavarde ! Les fouilles menées depuis 2014 sous l’égide du service
départemental d’archéologie de Charente-Maritime ont révélé bien plus que les attendus. On croyait jusqu’alors que le site du Fâ
avait commencé à vivre avec les Romains. Les recherches archéologiques ont permis de révéler qu’ils n’étaient pas les premiers
occupants, puisqu’à leur arrivée, la ville existait déjà... depuis cinq siècles ! Les Romains ont simplement réorganisé une cité dont
des fossés, des traces de poteaux de bois et des céramiques prouvent son ancienneté. Ces trouvailles, après un délai réservé à
leur étude et leur consolidation, alimentent le musée du site pour les plus spectaculaires d’entre elles : dès cet été une trentaine
d’objets supplémentaires, issus des fouilles de 2005, rejoindront le génie ailé de 70 cm de haut retrouvé la même année.
Les fouilles ont encore réservé d’autres surprises : il était admis jusque-là que le Fâ était désaffecté depuis le 3
ème
siècle après JC.
On sait désormais qu’il ne l’a été que 500 ans plus tard, au 8
ème
siècle. Ce bond temporel s’explique par le plan de fouilles. Jusque
là, n’avaient été sondés que les principaux monuments, effectivement délaissés, eux, dès le 3
ème
siècle. Toutes ces découvertes
modifient chaque année le discours des visites guidées qui s’enrichissent du travail archéologique au fur et à mesure des secrets
révélés. La prochaine campagne de fouilles est prévue en 2018.
BRGM
5
et l’IRSTEA allient alors leurs compétences pour étudier tout
à la fois la nappe phréatique, le mouvement des sédiments sur la
zone inondée, la population piscicole et l’évolution de la végétation.
Cette expérience a permis le retour sur Nouvelle de nombreuses
espèces d’oiseaux et de poissons. Elle nourrit aussi les récits des
guides naturalistes chargés d’accompagner les visiteurs dans leur
découverte de cet espace si particulier.
Sciences très humaines
Les sciences « dures » ne sont pas les seules à se pencher sur le sujet
«estuaire». Le projet QUEST intègre aussi la sociologie, l’économie ou
la géographie. Ainsi le devenir des zones inondables se pense entre les
préoccupations de valorisation économique des communes riveraines
et la réglementation nationale préférant les laisser en l’état pour ne pas
accentuer le risque d’inondation. Dans un autre registre, l’inventaire
du patrimoine, mené par le service régional de l’Inventaire et les
archives départementales de la Gironde, symbolise l’intérêt scien-
tifique pour l’espace estuarien. Pendant sept ans, leurs équipes ont
arpenté chacune des communes des deux rives pour
« une démarche
patrimoniale la plus large possible, justifiée par l’absence d’intérêt
jusqu’alors pour cette zone. »
Loin de ne s’attarder qu’aux châteaux,
comme l’inventaire des années 70, celui-ci s’est intéressé aux minus-
cules témoignages qui aident
« à comprendre comment l’homme a
façonné ce territoire et s’est adapté à lui »
, et saisir ce qui relie les
deux rives, malgré l’étendue d’eau.
4 - Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux
5 - Bureau de recherches géologiques et minières
1 - Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
2- Institutnationalderecherchesensciencesettechnologiespour l ‘environnementet l’agriculture
3 - Quel Est l’Etat de l’Estuaire ?
David de Souza et Olivier Souilhé ont rencontré une trentaine d’anciens
habitants des îles pour un projet à la frontière entre la sociologie,
la vidéo, le théâtre et le web-documentaire.
Site et musée
Ouverts en été tous les jours, jusqu’à
mi-septembre, de 10h à 19h.
En automne, mercredi, samedi
et dimanche de 14h à 18h.
05 46 90 43 66 ou
05 46 90 33 45
www.fa-barzan.comL’Île Nouvelle
©
Nous Autres
©
Thierry Girard
©
La Petite Canau
©
Nous Autres
©
Karine Robin / Conseil Départemental 17
L’Estuaire
étale ses
sciences
L’huître reprend son histoire
















